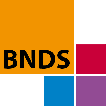|
Introduction
Première partie : Le signalement des événements indésirables associés aux soins en établissement de santé et la déclaration des événements indésirables graves aux autorités de tutelles
Chapitre 1. Les modalités de signalement interne des événements indésirables associés aux soins, les méthodes d’analyse et le retour d’information
Section 1. Le système de signalement interne et les méthodes d’analyse des événements indésirables associés aux soins
§ 1. Organisation du système de signalement des événements indésirables associés aux soins
A. La formalisation d’une procédure de signalement
1. Base légale et obligation de signalement des événements indésirables associés aux soins
2. Mise en œuvre des procédures de signalement
3. Des difficultés de mise en œuvre des procédures de signalement
B. La gestion des signalements des événements indésirables associés aux soins
1. Systèmes hétérogènes en fonction du type d’établissement et de la politique mise en œuvre
2. Un outil informatique favorisant l’information
3. Incitation des tutelles à la déclaration par l’octroi de financement sur demande : Le Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESSP)
§ 2. Les méthodes d’analyse du signalement des événements indésirables associés aux soins
A. Mesure et atteinte du seuil de la recevabilité statistique
1. Réalisation de statistiques à plat des pôles déclarants, axe de sensibilisation ciblée
2. Les contrats de pôle : objectifs d’amélioration de la déclaration
B. Ajuster la matrice de criticité aux réalités du terrain
1. En fonction de la typologie, de la fréquence des événements indésirables et grâce à des outils adaptés et améliorés au fil de l’expérience des acteurs
2. La criticité
C. Plan de maîtrise de non récidive du risque
1. Méthodes Alarm, Arbre des causes, RMM et l’analyse des expertises
2. Une culture embryonnaire en France et l’apparition de la notion de « gestion intégrée des risques » dans la littérature québécoise
Section 2. Une rétro-information élargie en faveur d’un retour d’expérience collectif
§ 1. Le retour d’information au déclarant, aux comités et aux instances
A. Retour d’information au déclarant
1. Rapport d’analyse
2. Consultation et mutualisation du retour d’expérience
B. Le comité d’analyse des risques associés aux soins
1. Gage d’un « fonctionnement transversal et décloisonné » et rôle de premier filtre
2. La composition du comité : le caractère indispensable d’un groupe expert issu de la communauté médicale
C. Information aux instances : un rapport d’activité obligatoire sur la gestion des événements indésirables liés aux soins et à la prise en charge du patient
1. Objectifs internes et contenu du rapport d’activité
2. Validation et retour d’Information ciblé pour une amélioration des pratiques et de l’organisation
§ 2. Information aux autorités de tutelles
A. Transmission du rapport d’activité à l’agence régionale de santé
1. Retour suite à l’envoi du rapport après validation par les instances internes
2. Spécificité de l’activité des Urgences : obligation légale d’information
B. La procédure de certification
1. La gestion des événements indésirables, critère 8.F, une pratique exigible prioritaire (PEP)
2. Enjeu de l’information en termes d’affichage
Chapitre 2. La déclaration des événements indésirables graves aux autorités de tutelles
Section 1. Le principe d’une obligation de déclaration à l’autorité administrative compétente des « événements indésirables graves liés à des soins »
§ 1. Une conception de l’erreur comme systémique
A. Le caractère évitable des EIG
1. Enquêtes ENEIS 2004 et 2009
2. Les critères d’appréciation du caractère évitable dans les enquêtes ENEIS
B. Approche sociologique de la notion d’EIG
§ 2. Expérimentation par l’INVS
A. Circuit de l’information relative à la déclaration
1. Niveau local
2. Niveau régional
3. Niveau national
B. Limites du dispositif expérimenté
1. Les déclarations doubles ou multiples et la méconnaissance des dispositifs et de ses acteurs
2. Une sous déclaration des EIG les moins graves et la persévérance d’une sous déclaration par crainte de la sanction
Section 2. Le circuit et les suites données à la déclaration
§ 1. Exemple de l’ARS Nord-Pas-de-Calais (NPDC)
A. Le point focal régional (PFR)
B. L’inspection générale régionale
§ 2. Une pertinence relative de la remontée d’information à l’échelon régional
A. Positionnement et rôle d’accompagnement de l’ARS
B. Perspective d’exploitation des données détenues par l’UNCAM
1. Rapport « Mission sur la gestion des risques » de l’IGAS (2010)
2. La stratégie nationale d’amélioration de la sécurité des soins
Seconde partie : L’information relative aux événements indésirables associés aux soins survenus et l’intégration d’une culture de sécurité
Chapitre 1. L’information relative aux événements indésirables associés aux soins survenus
Section 1. L’information : droit des patients
§ 1. Un besoin d’être informé
A. Contexte historique de la demande sociale d’information sur les risques
1. Principe de précaution appliqué à la pratique de la médecine
2. Valorisation du droit des patients : la démocratie sanitaire, l’information et la médiation
B. Réponse aux attentes : la loi du 4 mars 2002 et le rôle de la HAS
C. Adéquation de la réponse aux attentes réelles
§ 2. L’impact et le périmètre du droit à l’information
A. Perception et niveau d’acceptabilité des risques associés aux soins
B. L’annonce du dommage et l’objectif de continuité de prise en charge
1. L’événement indésirable associé aux soins : aucun préjudice pour le patient
2. Communiquer : les notions d’information et de non information
Section 2. L’information : obligation des professionnels
§ 1. Une obligation d’informer
A. Contexte et évolution du cadre juridique de l’obligation générale d’information
1. Historique de la relation soignant/soigné
2. De l’obligation contractuelle au droit régalien du patient
B. Objectif de maintien ou restauration de la confiance soignant/patient : guider le soignant dans l’annonce
1. Lignes directrices canadiennes de divulgation
2. Guide d’annonce d’un dommage associé aux soins
C. Une gestion collective de l’information : rôle de l’ensemble du service et de l’établissement
§ 2. L’impact de l’obligation d’informer et la nécessaire formation
A. Perception, niveau et limite d’acceptabilité sociale des risques associés aux soins
1. Étude Malis et étude interne à l’établissement
2. Le catastrophisme par inadvertance
B. Impact de l’obligation d’information sur les pratiques médicales : la médecine défensive
1. Conséquences pour le professionnel « seconde victime » et pour l’établissement
2. La médecine défensive face aux risques de judiciarisation
Chapitre 2. Vers de nouvelles sources d’information relative aux événements indésirables associés aux soins
Section 1. D’un statut de victime potentielle à une participation effective du patient
§ 1. Des dispositifs relais de l’information au service de l’expression du patient
A. Représentation au sein d’instances et mise à disposition d’un médiateur
1. La Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC)
2. Médiateur et Maison des usagers
B. Les questionnaires de satisfaction
1. Contenu, exploitation et perspective d’uniformisation
2. Traitement d’une plainte formulée par un questionnaire de satisfaction
3. Transmission et intégration des plaintes et réclamations au circuit des événements indésirables associés aux soins
§ 2. Vers une participation des patients au signalement et à l’analyse des événements indésirables associés aux soins
A. La participation effective du patient au signalement
1. L’accès des patients aux outils de signalement
2. Le signalement préventif des risques d’événement indésirables
B. La participation effective du patient à l’analyse des événements indésirables associés aux soins
1. Les enjeux de la participation accrue du patient et/ou son entourage
2. Les freins observés en pratique et perspectives potentielles
Section 2. Une gestion a priori de l’information par les professionnels de santé
§ 1. Les méthodes de l’approche prédictive : une démarche proactive et préventive
A. L’analyse des modes de défaillances et de leurs effets (AMDE) et l’analyse des modes de défaillances et des criticités (AMDEC)
1. La méthode AMDE
2. La méthode AMDEC
A. L’analyse préliminaire des risques (APR)
1. La méthode d’analyse préliminaire des risques (APR)
2. Exemple d’APR des risques au bloc opératoire
§ 2. Le DPC et le pragmatisme gages de réceptivité et pérennité de l’information
A. Le DPC moteur de l’information préventive des événements indésirables associés aux soins
1. L’accréditation des médecins (spécialités à risque) reconnue comme un élément essentiel de la lutte contre les événements indésirables associés aux soins
2. Sélection d’événement porteur de risque (EPR)
B. Intégration de la simulation médicale au DPC
Conclusion
Bibliographie
|