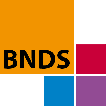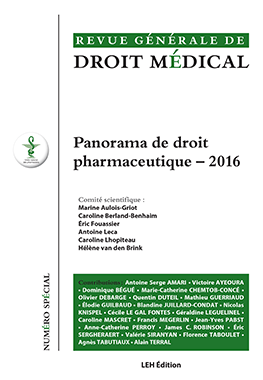0
Panier
0 €

L'équivalence thérapeutique : une notion bien équivoque !
Citer cet ouvrage :
L'équivalence thérapeutique : une notion bien équivoque ! ,PDP, n°4, p.49-66
Exporter vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS