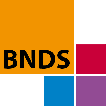0
Panier
0 €

La prise en charge de la transidentité
Theme :
Droit médical
,
Éthique médicale/Bioéthique
,
Citer cet ouvrage :
Schneider Héloïse, La prise en charge de la transidentité, Bordeaux, LEH Édition, 2013, coll. "Mémoires numériques de la BNDS",
Exporter vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS