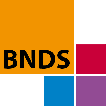|
Introduction
Chapitre 1. Caractérisée par l’existence de principes consacrant son indépendance, la médecine libérale française s’est érigée face aux risques de subordination du corps médical
Section 1. Les prémices de l’identité libérale de la médecine sont subséquentes à l’émergence des premiers organismes de socialisation de la consommation de soins.
§ 1. L’apparition des premières assurances maladie est intimement liée au contexte social du xixe siècle, et à la découverte du calcul des probabilités
§ 2. Les risques de subordination du corps médical portés par les premières assurances santé font émerger les premières manifestations de l’identité libérale du corps médical
Section 2. L’identité libérale du corps médical français s’est cristallisée en réaction au projet d’assurance maladie publique porté par un État dont les médecins redoutent les ambitions.
§ 1. Le développement de l’État social s’accompagne d’un projet d’assurance maladie publique
§ 2. La défiance des médecins à l’égard de l’État cristallise l’identité libérale de la médecine
Section 3. Les principes constitutifs de la médecine libérale traduisent l’indépendance des médecins français et sont présentés comme étant le gage d’une médecine de qualité
§ 1. Les principes entourant l’acte de soins.
§ 2. Les principes entourant le mode de rémunération des médecins
Section 4. La consécration des principes de la médecine libérale, ainsi que leur maintien, émanent du pouvoir politique des médecins
§ 1. Si la forte représentativité des médecins à l’Assemblée nationale est à l’origine de la consécration de la médecine libérale, le maintien de celle-ci ne lui est pas
imputable
§ 2. Ce sont les prérogatives législatives des médecins et la perception qu’ont les pouvoirs publics de leur puissance politique qui expliquent le maintien des principes de la médecine libérale.
Chapitre 2. La politique de régulation de la démographie médicale n’a jusqu’à présent pas permis de limiter l’impact néfaste de la liberté d’installation sur l’accès aux soins
Section 1. La liberté d’installation dont disposent les médecins libéraux est à l’origine d’un phénomène de désertification médicale menaçant l’accès aux soins
§ 1. Les médecins libéraux sont nombreux mais inégalement répartis
§ 2. Si les aspirations des médecins en termes de cadre et de qualité de vie sont à l’origine de leur inégale répartition, ce sont le principe de liberté d’installation et les spécificités du marché médical qui l’autorisent
§ 3. Les ambiguïtés entourant la notion de « déserts médicaux » ne doivent pas masquer l’existence de véritables difficultés d’accès aux soins
§ 4. Loin d’être à relativiser, le phénomène de désertification médicale est appelé à s’accentuer durant la prochaine décennie
Section 2. Les pouvoirs publics peinent à mettre en œuvre une politique efficace de régulation de la démographie médicale
§ 1. Les politiques de régulation de la démographie médicale conduites jusqu’alors accusent de nombreuses limites
§ 2. Si la nécessité de la mise en place d’une régulation plus coercitive de la politique de régulation de la démographie médicale est de plus en plus partagée, elle ne parvient pas à se mettre en place
Chapitre 3. La capacité que possèdent un nombre croissant de médecins libéraux de facturer des dépassements d’honoraires nuit à l’accès aux soins
Section 1. Alors qu’elle constitue la clef de voûte de l’Assurance maladie, l’opposabilité des honoraires facturés par les médecins fait toujours l’objet de multiples dérogations
§ 1. L’échec du conventionnement des honoraires médicaux est une constante de l’histoire de quatre-vingt années de relations entre médecins et caisses d’assurance maladie
§ 2. La convention médicale de de 2011 aménage encore de nombreuses dérogations au principe du conventionnement des honoraires médicaux
Section 2. Sans que cela ne semble être justifié par des facteurs objectifs, le montant des dépassements d’honoraires a plus que doublé depuis une vingtaine d’années
§ 1. La croissance des dépassements d’honoraires est due à l’augmentation des taux de dépassements facturés, et dans une moindre mesure à celle de la part de médecins disposant de la liberté tarifaire
§ 3. Le choix du secteur 2 et la détermination du montant des dépassements sont liés à la recherche d’un revenu cible, et non à la faiblesse des revenus de la profession ou à la qualité des actes que le praticien
Section 3. Puisqu’ils ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie, les dépassements d’honoraires restreignent l’accès aux soins des assurés sociaux
Section 4. Le cadre légal entourant la pratique des dépassements d’honoraires ne permet pas de protéger efficacement les assurés sociaux
§ 1. Le respect du « tact et de mesure » dans la facturation des dépassements n’est pas assuré
§ 2. L’information des patients sur les pratiques tarifaires n’est pas toujours respectée et n’obtient pas les effets escomptés
§ 3. L’interdiction de facturer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C n’est pas toujours respectée
Section 5. Présenté comme le meilleur moyen de d’amélioration de l’accès financier aux soins, le secteur optionnel devrait en réalité conduire à une exacerbation des inégalités
§ 1. Le secteur optionnel vise à améliorer l’accès aux soins et à résoudre le problème des anciens Accas bloqués en secteur 1
§ 2. La création du secteur optionnel est pour l’instant rendue impossible
§ 3. Loin d’atteindre ces objectifs, le secteur optionnel devrait conduire à aggraver la situation de l’accès financier aux soins
Conclusion
Bibliographie
|