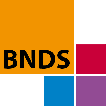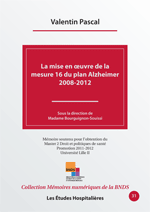0
Panier
0 €

La mise en œuvre de la mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012
Citer cet ouvrage :
Pascal Valentin, La mise en œuvre de la mesure 16 du plan Alzheimer 2008-2012, Bordeaux, LEH Édition, 2013, coll. "Mémoires numériques de la BNDS",
Exporter vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS
Télécharge un fichier pour utilisation dans EasyBib, Mendeley, Zotero, etc.
EXPORTER vers RIS